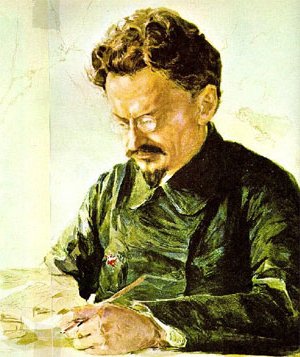C'est
une fois de plus un article signé G. Gourov - daté du
15 juillet 1933 - qui apprend aux oppositionnels du monde que
« le
Vieux », après six mois d'observation de la
« marche des événements », se
prononce désormais pour la création de nouveaux partis
communistes et pour une nouvelle Internationale dont la logique des
nombres va faire la Quatrième.
C'est un tournant capital, le plus important sans doute de sa vie.
Publié d'abord dans les bulletins intérieurs, il accède
plus tard à la presse oppositionnelle.
Trotsky
commence par essayer de dresser un bilan de la politique de
« réformes », de l'Internationale et de
ses sections, les partis communistes. Disposant, en dehors de l'Union
soviétique de forces militantes très faibles, pour ne
pas dire dérisoires, l'Opposition, dans sa propagande pour une
« réforme », a pu s'appuyer sur les
événements de la lutte des classes mondiale, ces
défaites qui, écrit-il, « mettaient à
nu la politique du centralisme bureaucratique ». Mais elle
se heurtait en même temps partout à des mesures de
répression de l'appareil stalinien, exclusions, calomnies,
violences. Bien que son existence ait constitué un facteur
réel de la politique de la direction qui n'a jamais cessé
d'en tenir compte, il n'est pas possible de revendiquer un quelconque
succès réel de la politique de réforme. Il pense
qu'on peut dire au contraire que l'échec de l'Opposition, dans
sa tentative pour engager l'Internationale dans un processus de
réforme, a finalement été l'une des causes de la
dégénérescence de cette dernière. C'est
du moins ce qui apparaît maintenant, après la nécessaire
vérification des événements par la vie.
Trotsky
défend la position qu'il a prise sur l'Internationale et les
autres partis au moment de l'effondrement du K.P.D. : personne
à
l'époque ne pouvait affirmer avec une certitude totale qu'il
n'existait aucune possibilité d'un réveil de certains
partis voire d'une fraction de l’I.C. qu'il fallait, dans ce cas,
aider. Là aussi, la preuve ne pouvait venir que de
l'expérience et de la vérification. Il estime qu'elle
est désormais faite. Tout le développement depuis le 30
janvier témoigne de ce que les événements
d'Allemagne n'ont pas tranché seulement du sort du parti
allemand, le K.P.D., mais de celui de l'Internationale tout entière.
Le nazisme a vaincu sans avoir à combattre. Les dirigeants
communistes n'ont même pas envisagé leurs
responsabilités dans ce désastre. Rappelant en quelques
mots les affirmations des organismes dirigeants de l'Internationale,
le silence dans les rangs des partis où l'on continue bien
souvent de se comporter et d'écrire comme s'il n'y avait pas
eu de catastrophe allemande, il dresse ce constat de décès :
« Une organisation
que n'a pas
réveillée le tonnerre du fascisme et qui supporte
humblement de tels outrages de la part de la bureaucratie démontre
par là même qu'elle est morte et que rien ne la
ressuscitera3. »
Rien
ne se termine pourtant avec un tel constat et, au contraire, tout
commence. En août 1914, à la faillite de la IIe
Internationale, les révolutionnaires dans les rangs de la
social-démocratie ont riposté en se mettant à
préparer la IIIe Internationale, née
officiellement cinq ans plus tard. La nécessité de
l'Internationale ne disparaît pas pour autant après
cette deuxième faillite, 1933 après 1914. C'est
maintenant de l'effondrement historique de l'Internationale
communiste qu'il faut partir. A ceux que la banqueroute de deux
internationales à la suite en moins de vingt ans a rendus
sceptiques, à ceux qui demandent quelle garantie ils ont que
la IVe Internationale ne dégénérera
pas à son tour, Trotsky ne peut répondre que parce qui
est une évidence à ses yeux : « Il nous
faut avancer sur un chemin coupé d'obstacles et encombré
de débris du passé. Que celui qui s'en effraye passe à
côté4. »
Bien
entendu, il ne néglige pas non plus les réserves émises
par ceux qui relèvent particulièrement la faiblesse du
groupe oppositionnel à l'échelle mondiale, la lenteur
de son développement, voire ses reculs, les crises qui l'ont
secoué et le secouent encore. Il pense, quant à lui,
que ces traits sont liés à la marche générale
de la lutte de classes, précisément marquée
depuis des années par de graves défaites. Et il ajoute
une remarque tirée de l'expérience historique :
c'est dans le cours de ces périodes de reflux que se sont
toujours trempés les futurs cadres de la révolution.
Les
prémisses nécessaires à une nouvelle
organisation de l'avant-garde existent-elles ? En d'autres
termes, qui les bolcheviks-léninistes vont-ils enrôler
sous leur drapeau au moment où la faillite de l'Internationale
en Allemagne détourne du communisme tant de militants écœurés
par le stalinisme ? Trotsky répond que les prémisses
sont créées précisément par la
décomposition de la social-démocratie : des
centaines de milliers et peut-être des millions en Allemagne
s'éloignent en effet du communisme, mais des dizaines de
milliers d'ouvriers social-démocrates se dirigent vers lui en
tournant le dos simultanément à la social-démocratie
et au stalinisme comme l'indique à ses yeux l'expérience
du S.A.P (Parti socialiste ouvrier). Il faut de l'audace, et Trotsky
invite ses camarades de tous les pays à entamer aussitôt
avec les organisations socialistes de gauche des pourparlers sur le
programme d'une nouvelle organisation révolutionnaire. Il
ajoute que c'est précisément la formation dans
plusieurs pays de fortes organisations révolutionnaires qui
attirera finalement nombre d'éléments militants encore
prisonniers dans les partis communistes et donnera à la jeune
génération ouvrière la réponse qu'elle
cherche.
Le
problème de l'U.R.S.S. est évidemment au centre des
problèmes politiques posés par la situation nouvelle.
Là aussi, Trotsky part de la contradiction qui existe entre le
caractère historique progressiste de l'Etat soviétique
fondé sur « les conquêtes d'octobre »
et le rôle réactionnaire de la bureaucratie stalinienne
installée sur ses fondements en parasite et usurpatrice,
monopolisant le pouvoir. A partir de là, on peut, pour lui,
aborder le problème de la nature du parti communiste au
pouvoir en U.R.S.S. où se retrouve la même
contradiction, bien que sous une forme légèrement
différente :
« Le P.C. actuel de
l'Union
soviétique n'est pas un parti, c'est un appareil
d'administration aux mains d'une bureaucratie incontrôlée.
Dans les rangs du parti communiste d'Union soviétique et en
dehors, se groupent les éléments dispersés de
deux partis principaux : le parti européen et le parti
thermidorien-bonapartiste. Se situant au-dessus de ces deux partis,
la bureaucratie stalinienne mène une lutte d'extermination
contre les bolcheviks-léninistes5. »
De
toute évidence, l'exilé hésite encore à
se prononcer sur la question du parti en U.R.S.S. comme le montre
assez nettement le passage suivant consacré à
l'explication du lien dialectique entre l'Union soviétique et
le mouvement ouvrier mondial, c'est-à-dire le développement
de la nouvelle Internationale :
« Si, sans révolution
prolétarienne en Occident, l'U.R.S.S. ne peut parvenir au
socialisme, sans la régénérescence d'une
véritable Internationale prolétarienne, les
bolcheviks-léninistes ne pourront par leurs propres forces
régénérer le parti bolchevique ni sauver la
dictature du prolétariat. [...] Seule la création d'une
Internationale marxiste, totalement indépendante de la
bureaucratie stalinienne et politiquement opposée à
elle, peut sauver l'Union soviétique de l'effondrement, en
liant son sort ultérieur à celui de la révolution
prolétarienne mondiale6. »
Trotsky
souligne que ses thèses ainsi présentées n'ont
pour objectif que de rechercher un accord de principe constatant la
fin d'une période historique et ouvrant dans des conditions
nouvelles une perspective nouvelle. A tous ceux qui s'émeuvent
ou s'indignent à l'idée de voir l'Opposition de gauche,
qu'ils considèrent comme une secte, se proclamer elle-même
ou proclamer avec quelques autres organisations d'importance diverse
la naissance de la IVe Internationale, il répond
dans un dernier paragraphe qui fixe avec précision les tâches
du moment à partir de la reconnaissance des principes qu'il
vient d'exposer :
« Il ne s'agit pas en
tout cas
de proclamer immédiatement de nouveaux partis et une
Internationale indépendante, mais de les préparer. La
nouvelle perspective signifie avant tout qu'il faut définitivement
rejeter comme utopiques et réactionnaires les phrases sur la
"réforme" et la revendication de la réintégration
des révolutionnaires dans les partis officiels. Le travail
quotidien doit revêtir un caractère indépendant,
déterminé par les possibilités et les forces en
présence, et non par l'idée formelle de "fraction".
L'Opposition de gauche cesse définitivement de se considérer
comme une opposition et d'agir comme telle. Elle devient une
organisation indépendante qui se fraie sa voie par elle-même.
Non seulement elle constitue ses propres fractions au sein de la
social-démocratie et des partis staliniens, mais elle mène
un travail autonome parmi les sans-parti et les ouvriers inorganisés.
Elle se constitue des points d'appui à l'intérieur des
syndicats, indépendamment de la politique syndicale de la
bureaucratie stalinienne. Là et quand les conditions sont
favorables, elle participe aux élections sous son propre
drapeau. Vis-à-vis des organisations réformistes et
centristes (staliniens compris), elle s'oriente en fonction des
principes généraux de la politique du front unique. En
particulier et surtout, elle applique la politique du front unique
pour la défense de l'Union soviétique contre une
intervention extérieure ou une contre-révolution
intérieure7. »
Quelques
jours plus tard, le 20 juillet 1933, sur le bateau qui le conduit en
France, Trotsky revient sur la même question en écrivant,
sous la forme d'un dialogue où il est l'un des deux
interlocuteurs, un article pour la presse de l'Opposition intitulé
« Il est impossible de rester dans la même
Internationale que Staline, Manouilsky, Lozovsky et Cie8 ».
L'initiative
est surprenante en elle-même. Les arguments utilisés
dans le nouveau texte sont certes plus agitatifs et visiblement
destinés à un public plus large, peu familier avec le
langage des « thèses » dans la tradition
bolchevique. On notera cependant que, pendant les cinq jours qui se
sont écoulés entre les deux articles, la pensée
de Trotsky s'est développée et qu'il arrive à de
nouvelles conclusions. Rien d'étonnant à ce que Pierre
Frank, qui l'a accompagné en ces jours et semaines de
réflexion, assure qu'il a véritablement imposé
alors à sa pensée un effort extraordinaire et pour
ainsi dire physique.
Il
entre cette fois directement dans le vif du sujet : il faut,
écrit-il, rompre avec la « caricature
d'Internationale de Moscou » qui, après avoir mis
Hitler en selle, a osé proclamer sa propre infaillibilité.
Cette prétendue Internationale n'est plus en réalité
qu'une « clique », la clique stalinienne,
laquelle foule au pied sans vergogne les statuts et les règles
de l'organisation dont elle n'a pas convoqué de congrès
depuis déjà cinq ans.
L'épreuve
des faits l'a montré : après la catastrophe
allemande, l'Internationale communiste n'était plus viable
puisqu'elle n'a pas entendu la voix des événements. Le
parti allemand que la politique dictée par Staline avait
réduit au fil des années au squelette d'un appareil
corrompu et étranger aux masses, est mort. Le parti communiste
de l'Union soviétique, lui non plus, n'a ni congrès ni
réunions ni discussions ni presse. Il a été
contraint d'assister dans un silence total à l'arrivée
au pouvoir de Hitler, principale menace pour la révolution
mondiale et pour l'Etat soviétique lui-même.
La
question posée par l'Histoire est celle de la succession. Au
programme, à la fois opportuniste et aventuriste adopté
en 1928 au VIe congrès de l'Internationale
communiste, il faut en opposer un autre. Ces fondements existent,
« le fondement marxiste irréprochable »
des décisions et résolutions des quatre premiers
congrès de l'Internationale communiste, tenus du vivant de
Lénine, sur la base desquelles les bolcheviks-léninistes
construiront le nécessaire programme de la révolution
prolétarienne. Ce n'est que par cette méthode,
insiste-t-il, que l'héritage du bolchevisme pourra être
préservé contre « les falsificateurs
centristes […], les usurpateurs du drapeau de Lénine, les
organisateurs des défaites et des capitulations, les
corrupteurs de l'avant-garde prolétarienne : les
staliniens9 ».
Sur
l'Union soviétique, il ne se contente pas de dire autrement ce
qu'il a déjà écrit le 15 dans ses thèses.
Il rappelle comment la révolution d'Octobre, avec le parti
bolchevique, a fondé l'Etat ouvrier et ajoute ces deux
phrases, capitales pour la compréhension de sa politique
ultérieure vis-à-vis de l'Union soviétique :
« Maintenant, le
parti
bolchevique n'existe plus. Mais le contenu social fondamental de la
révolution d'Octobre est encore vivant10. »
Trotsky
explique que ses camarades et lui-même, notamment dans les
années d'opposition à l'intérieur du parti, mais
aussi après leur exclusion formelle, ont longtemps cru à
la possibilité de régénérer le parti et,
par conséquent, à travers lui, de régénérer
le système soviétique. Or ce qu'on appelle « le
parti » en U.R.S.S. n'a plus rien d'un parti. Contre tout
ce qui subsistait de l'ancien parti bolchevique dans le cadre de
l'organisation de pouvoir et au pouvoir, la bureaucratie a déchaîné
la plus féroce répression : il s'agissait de le
désorganiser, de le terroriser, de le priver de toute
possibilité de penser et d'agir. Maintenant il s'agit
d'empêcher sa régénération. Après
des années de polémique contre les partisans du
« deuxième parti » en U.R.S.S., Trotsky
estime que le moment est venu de prendre acte du changement
qualitatif intervenu en Union soviétique et d'en tirer les
conclusions d'orientations qui s'imposent : « En
U.R.S.S., il faut construire de nouveau un parti bolchevique11. »
A
la question de savoir si un tel mot d'ordre ne signifie pas un appel
à la « guerre civile », il répond
que l'Union soviétique vit depuis des années une guerre
civile. Après celle que la bureaucratie, appuyée par
les forces contre-révolutionnaires, a menée contre
l'Opposition de gauche, on assiste maintenant à celle des
forces contre-révolutionnaires contre la bureaucratie
stalinienne, avec à l'horizon la menace mortelle de la guerre
déclenchée par le régime hitlérien. Les
bolcheviks-léninistes se battront de toutes leurs forces face
à la contre-révolution : ils seront,
proclame-t-il, « l'aile gauche du front soviétique ».
La
tâche ainsi déterminée ne dépasse-t-elle
pas, et de loin, les forces des bolcheviks-léninistes dans le
monde ? Trotsky répond que la question n'a pas encore été
abordée. En bonne méthode marxiste, il s'agit d'abord
de formuler ce qu'est la tâche historique. On s'efforcera
ensuite, une fois l'accord réalisé dans l'ensemble, de
rassembler les forces nécessaires. Répétant que
ce serait de l'aventurisme pur que de vouloir que l'opposition
déclare qu'elle est elle-même « la nouvelle
Internationale », il réaffirme avec force qu'il
faut proclamer la nécessité de cette dernière et
invoque l'autorité de Ferdinand Lassalle pour qui « toute
grande action commence par l'expression de ce qui est ».
Il
ne nie pas la possibilité d'importantes variantes dans les
attitudes prises par les sections nationales de l'I.C. : elles
ne peuvent en aucun cas modifier l'orientation vers une nouvelle
Internationale, imposée par l’ensemble de la situation, non
par ses détails ou exceptions.
Il
est également tout à fait certain que ce tournant vers
la nouvelle Internationale va éloigner de l'Opposition des
éléments des partis communistes officiels qui ont été
jusqu'à présent sensibles à ses arguments et ont
sympathisé avec elle. Il pense qu'ils reviendront à une
étape ultérieure. D'ici là, l'entreprise aura
gagné des éléments anciens, exclus, qui
s'étaient tenus à l'écart de la ligne de la
« fraction » et de la « réforme »
à laquelle ils ne croyaient plus, travailleurs en rupture avec
« le réformisme », et surtout « la
jeune génération d'ouvriers à qui il faut un
parti sans tache ». Confiant, il assure, comme un coup de
clairon dans un discours public :
« Alors, tout ce
qu'il y a de
vivant dans l'''Internationale" stalinienne secouera ses
derniers doutes et nous rejoindra12. »
Il
ajoute qu'il s'attend à beaucoup de résistance dans les
rangs de sa propre organisation, mais qu'une discussion
« large
et sérieuse », ainsi que les événements.
apporteront toujours plus d'arguments et finiront par convaincre les
éléments les plus attachés aux formules et
attitudes du passé.
*
* *
On
ne peut qu'être impressionné, à la lecture de ces
deux textes fondamentaux, par la détermination de Trotsky et
ce qu'on est tenté d'appeler chez lui la force de l'idée
- et par l'optimisme qui en résulte. Il sait bien entendu
qu'il n'est pas le seul de la vieille garde communiste à avoir
dressé le constat de faillite de l’I.C. et à avoir
compris la nécessité d'une nouvelle Internationale. Il
est apparemment convaincu que ses camarades d'Union soviétique,
et, au premier rang d'entre eux, Rakovsky, malgré leur manque
d'informations internationales, ont pu mesurer l'importance de la
« catastrophe allemande » et comprendront la
nécessité comme les objectifs du tournant.
Il
a autour de lui d'autres vétérans ou pionniers du
communisme, dont il sait qu'ils sont prêts à s'engager
sur le difficile chemin parsemé de nombreux obstacles ;
les Espagnols Nin, Andrade, Garcia Palacios, les Italiens Leonetti et
Tresso, l'Allemand Grylewicz, les Américains Cannon, Swabeck,
Shachtman, le Belge Lesoil, le Slovaque Lenoravic, l'Allemand des
Sudètes Neurath, le Bulgare Gatchev, le Hollandais Sneevliet
qui vont les rejoindre parce qu'ils rompent avec la politique de
« réforme ». Ce sont tous de ces
pionniers qui ont construit de leurs mains l'Internationale
communiste, la IIIe, et vont s'engager avec lui
dans la
construction de la IVe. La IIIe
Internationale
en ses débuts n'avait pas autant de cadres aussi solides issus
de rangs de la IIe.
On
a même à le lire le sentiment que la force de l'idée,
issue de la nécessité et de la conviction autant que du
fonctionnement de cet exceptionnel cerveau, en vient à nourrir
une certaine allégresse, particulièrement sensible dans
l'article du 20 juillet. On ne peut cependant douter de la difficulté
et même de la souffrance qu'il éprouva à se
séparer de la IIIe Internationale avec laquelle
il
s'était, pendant des années, identifié dans le
prolongement de cette révolution d'Octobre à laquelle,
malgré tant d'efforts de suppression et de falsification, son
nom est et restera attaché. Il lui fallut certainement
beaucoup de détermination pour exprimer ce qu'il présenta
dans ses textes comme une simple constatation mais qui, dans sa
formulation, dut être pour lui un véritable arrachement.
Certains
communistes relativement proches lui font alors grief de mettre sur
le même plan, sous l'étiquette de « 4 août »,
la trahison des social-démocrates en 1914 et celle des
communistes en 1933 : selon ces critiques, les premiers
auraient
délibérément et sciemment trahi la cause qu'ils
avaient pour mission de défendre, tandis que les seconds
auraient été seulement totalement désorientés,
les premiers seraient allés en direction des fauteuils
ministériels et les seconds vers les cellules des prisons. Il
admet qu'il y a là un grain de vérité, mais pas
plus. Les dirigeants social-démocrates allemands en 1914,
ainsi que les dirigeants staliniens de 1933, ont en fait obéi
avant tout au souci de défendre non le prolétariat en
tant que classe, mais l'appareil, dont ils étaient les
fonctionnaires et qui était aussi leur moyen d'existence. Ce
qui est capital à ses yeux, c'est que c'est dans l'intérêt
d'une couche sociale particulière et d'intérêts
privés que les représentants du prolétariat dans
ces partis officiels sont passés de l'autre côté,
renforçant par leur attitude l'ennemi de classe.
A
ses yeux, les conséquences de la « trahison »
stalinienne, qui se révèlent en 1933, sont infiniment
plus dramatiques et d'une beaucoup plus grande portée que
celles de 1914. Il s'agit en effet de la seconde faillite en vingt
ans, de l'écroulement répété de l'édifice
de l'Internationale sur ses constructeurs. Combien d'entre eux se
lanceront-ils pour la deuxième fois dans le terrible combat où
ils ont déjà vu s'écrouler l'ouvrage de leur
vie ? Il relève d'ailleurs, en liaison avec cette
première remarque, que l'organisme de la IIe
Internationale avait eu plus de réaction en 1914 que celui de
la III Internationale en 1933. La catastrophe allemande, la victoire
sans combat de Hitler, n'a dressé contre la direction aucun
Liebknecht, aucune Rosa Luxemburg, pour dénoncer de
l'intérieur la « trahison » des chefs.
L'apathie et la démoralisation manifestées par la base
des partis de la IIIe Internationale face à la
débâcle allemande lui apparaissent comme le phénomène
le plus lourd de conséquences, d'une portée
incalculable.
L'idée
de proclamer la IVe Internationale a été
vivement critiquée dans les rangs des partisans de Trotsky et
plus encore de ses sympathisants, de 1933 à 1938, date de sa
« proclamation ». Ces critiques étaient
pour la plupart des hommes qui s'en disaient partisans, mais qui,
comme les militants de la section polonaise, jugeaient le moment
inopportun et prédisaient l'échec d'une entreprise
selon eux mal engagée, de Pivert et Victor Serge à
Guttmann et aux Polonais.
L'argument
principal était que les deux Internationales précédentes
avaient été fondées dans des périodes
révolutionnaires, alors que la victoire des nazis en Allemagne
venait d'ouvrir pour le prolétariat une période de
reflux et de terribles défaites. Ils soulignaient aussi que
Marx, comme Lénine, avaient attendu le moment favorable pour
une « proclamation » et n'avaient pas cherché
à appliquer mécaniquement une nécessité
historique. Toujours selon eux, les Internationales précédentes
s'étaient appuyées sur l'existence de forts partis
nationaux, alors que la IVe Internationale
n'avait, pour
sa part, aucune base en partis de masse. Ils attiraient aussi
l'attention sur le fait que la IVe
Internationale aurait à
être construite face à deux rivales déjà
solidement établies et disposant de moyens matériels
réels importants, et ce à un moment où elle ne
pouvait s'attendre qu'à une répression accrue.
Ces
affirmations contiennent une bonne part de vérité. Il
faut cependant les nuancer si l'on veut comprendre la démarche
de Trotsky. Il est vrai que la IIe et la IIIe
Internationale étaient à cette époque des
organisations puissantes et bien établies. Mais il est vrai
également qu'elles traversaient une crise profonde, et c'est
précisément sur cette donnée que Trotsky faisait
reposer les fondements de son tournant. La IIIe
Internationale avait dû livrer de durs combats pour se
développer au détriment de la IIe. Mais ces
deux Internationales étaient-elles vraiment nées dans
une «marée haute » ? La IIe
était née d'un accord entre partis existants, la IIIe
moins de la marée haute de l'après-guerre que de son
premier résultat en pleine guerre : la victoire de la
révolution russe.
Trotsky
avait été membre de la IIe Internationale,
avait connu de près la plupart de ses dirigeants, participé
à nombre de ses congrès. Il avait été
l'un des fondateurs et incontestablement l'orateur-vedette de la
fondation et des débuts de la IIIe. Mieux que
tout
autre, il disposait donc d'éléments de comparaison en
ce qui concerne les circonstances de la naissance de la IIIe
Internationale qui devait lui servir de point de référence
pour celle de la IVe.
La
IIIe Internationale avait à ses débuts
rassemblé dans ses rangs nombre d'éléments issus
des diverses gauches et même du « centre »
de la IIe. Zinoviev, au congrès de Halle,
assurait
que le ralliement à l'Internationale communiste du parti
social-démocrate indépendant (U.S.P.D.) signifiait le
ralliement de la « vieille école »
social-démocrate révolutionnaire à
l'organisation née de l'élan de la révolution
russe.
Au
fond, la IIIe Internationale était née
directement des initiatives du parti bolchevique qui avait mené
à la victoire une révolution ouvrière et
paysanne et avait été partie intégrante de la
IIe Internationale. Le parti bolchevique, le
P.O.S.D.R. de
Lénine, était en réalité le parti russe,
aussi traditionnel pour l'Empire du tsar que l'était le parti
social-démocrate allemand pour l'Empire allemand. Par son
développement et son histoire, par son ambiance comme par ses
traditions, il était en quelque sorte un parti établi -
avec d'autres, des concurrents comme les socialistes révolutionnaires
- à la direction de la classe ouvrière russe depuis des
années.
Il
n'y avait rien de tel au bénéfice de la IVe
Internationale à la fin des années trente, et ses
partis - ou, si l'on préfère, ses sections avaient donc
à s'imposer de l'extérieur et à partir de rien.
Certains pionniers du mouvement communiste avaient certes accompagné
Trotsky sur ses affiches, mais elle allait être, pour
l'essentiel, formée de militants de la dernière
génération, venus des partis socialistes et
communistes, exclus, marginalisés aussi par leurs soins. Les
deux organisations traditionnelles auxquelles se heurtait la IVe
Internationale, puissantes bien qu'en crise, étaient avant
tout des appareils disposant de moyens matériels, et
s'appuyant sur la routine. Trotsky allait plus loin et pensait que
les deux anciennes Internationales prenaient appui sur la force
d'inertie, la lassitude, le découragement, le scepticisme,
sans compter le réseau des influences et des intérêts
matériels. Et c'était précisément là
ce qui justifiait à ses yeux l'appel à une nouvelle
Internationale.
Soulignons-le,
la « faillite » des partis communistes et de
l'Internationale ne signifiait pas pour lui qu'ils avaient cessé
d'exister. Ils avaient cessé d'être un facteur
révolutionnaire, et c'était en cela qu'ils avaient fait
faillite. Ils subsistaient, en tant qu'organisations, comme des
obstacles sur la voie de la révolution, des obstacles qu'il
faudrait surmonter. Et Trotsky, en parlant de
« faillite »,
n'a jamais prédit leur disparition - sauf à la suite de
la victoire de la révolution.
Trotsky
se rendait bien compte qu'il appelait à la lutte pour
construire la IVe Internationale en plein
reflux, sous le
signe d'une terrible défaite. C'était même là
ce qui rendait son appel nécessaire et d'autant plus urgent à
ses yeux. Il argumentait : l'appel pour la IIIe
Internationale n'avait-il pas été lancé dès
l'été 1914, au moment de l'effondrement de la IIe
et de sa « faillite », avec le reniement des
chefs et la reddition des troupes ? Et cet appel n'avait
effectivement abouti, en pleine marée, que cinq ans plus tard,
à l'appel des bolcheviks au pouvoir.
Sa
correspondance démontre qu'il avait pleinement conscience des
obstacles auxquels allait se heurter l'entreprise à laquelle
il appelait l'avant-garde de l'avant-garde. Le principal était
à ses yeux la faiblesse et le petit nombre de cadres
disponibles et le rôle excessif qui lui incombait à lui,
à un moment où sa santé n'était pas bonne
et où sa sécurité était de plus en plus
précaire. C'était la tâche qu'il tentait de
résoudre en s'attachant, malgré sa. répugnance,
aux « problèmes des sections », essayant
de discuter avec tous et de ne pas perdre un seul militant. C'était
le rassemblement, puis la trempe de ces cadres qui constituaient à
ses yeux la tâche essentielle pour la construction de la IVe
Internationale à partir de 1933, comme ils l'avaient été
pour le parti bolchevique entre 1903 et 1914 - une dépression
à laquelle il avait survécu grâce à ses
cadres.
Il
reste - et ce n'est pas le moins important -le problème des
délais. Quand Trotsky, en 1934, traçait les
perspectives de la IVe Internationale, qu'il
n'appelait
pas encore à proclamer, il la voyait naître de
« nouveaux congrès de Tours », de la
radicalisation d'ailes entières de partis socialistes ou
communistes, voire de syndicats et dans les « grands
événements » : grèves,
soulèvements prolétariens. Ses propres partisans, les
« bolcheviks-léninistes », ne devaient
être à ses yeux qu'une fraction dans l'Internationale en
construction. Ce schéma était cohérent,
nullement extravagant. Mais dans quel délai ? Les
événements de 1936 - grèves de juin en France et
en Belgique, début de la guerre civile en Espagne - n'ont pas
apporté aux partisans de Trotsky l'audience de masse qu'il
avait espérée. Le Front populaire les a disloqués.
Quand
il se décide, en 1938, à proclamer la IVe
Internationale avec les seules forces de sa fraction, c'est, bien
entendu, parce qu'il veut disposer, avant la guerre qui vient, de
l'arme d'une organisation et d'un programme, nécessités
jumelles et complémentaires. Mais apprécie-t-il
correctement les délais ?
Le
18 octobre 1938, dans un discours enregistré pour ses
camarades américains, il devait en effet assurer :
« Permettez-moi une
prédiction ! Dans les dix années qui viennent, le
programme de la IVe Internationale deviendra le
guide de
millions d'hommes, et des millions de révolutionnaires sauront
prendre d'assaut le ciel et la terre13. »
Impossible
de ne pas reconnaître que cette prédiction-là a
été cruellement démentie et qu'il péchait
au minimum par excès d'optimisme. Mais le délai n'était
sans doute pas à ses yeux l'essentiel.
Pour
lui, en effet, la crise ouverte par la faillite de la IIIe
Internationale, moins de vingt ans après celle de la IIe,
confirmait que la crise de l'humanité était bien celle
de la direction révolutionnaire. A cet événement
capital de l'histoire humaine que fut la victoire de Hitler, cette
première avancée de la barbarie dans le XXe
siècle, la défaite du prolétariat le mieux
éduqué et le mieux organisé du monde entier,
devait répondre une initiative sur le plan de la direction
révolutionnaire : ce fut le tournant vers une nouvelle
Internationale, préconisé avec quelques mois de recul.
de réflexion et d'attente.
Mais
pour Trotsky, la proclamation de la nécessité de
l'Internationale et sa construction s'imposaient presque
indépendamment de ses conséquences immédiates.
Comme le geste de Liebknecht refusant en 1914 le vote au Reichstag
des crédits militaires, comme la tenue de la conférence
de Zimmerwald en 1915, c'était pour lui le nœud qu'il fallait
faire à tout prix sur le fil de l'Histoire pour rétablir
une continuité brisée, et pour qu'au pire moment de la
Seconde Guerre mondiale l'humanité mourante et souffrante
puisse disposer, même précaire et encore en pièces
et morceaux, de l'Internationale - drapeau et programme - qu'elle
n'avait pas eue de 1914 à 1918. Ni plus, ni moins.
De
ce point de vue, on peut s'étonner que Trotsky ait pris le
risque de se laisser aller à une prophétie. Quand il
avait formulé la perspective de la IVe
Internationale, il n'avait pas indiqué de délai pour sa
réalisation, et son appel à la lutte pour elle
signifiait seulement à ses yeux qu'il fallait continuer et,
suivant le précepte qu'il aimait à répéter,
se conformer à la règle morale suprême :
« Fais ce que dois, advienne que pourra. »
Peut-on
simplement imputer à l'optimisme révolutionnaire qui
inspirait ses grandes perspectives une prédiction qui allait
être cruellement démentie ? Trotsky s'attendait à
la Seconde Guerre mondiale dans un délai d'un ou deux ans.
Procédant par analogie avec la Première, il pensait
sans doute agir prudemment, en parlant d'une dizaine d'années,
alors que la révolution russe avait explosé à la
troisième année de guerre et alors que l'Internationale
nouvelle avait été créée cinq ans après
l'ouverture des hostilités.
Imagine-t-on
en outre Trotsky, attaché comme il l'était à
l'enseignement de Marx et de Lénine, prenant simplement acte
qu'il n'existait pas d'Internationale et passant à l'ordre du
jour ?