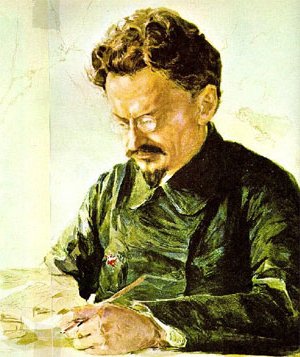Le 24 juillet 1933, le vapeur italien
Bulgaria qui
amène de Constantinople Trotsky avec Natalia, ses
collaborateurs et son dernier visiteur, s'arrête en mer au
petit matin sur instructions de la police marseillaise. Il est
alors rejoint au large par une vedette de la police à bord
de laquelle est monté Lev Sedov2. Déjouant
ainsi les journalistes qui les attendent au débarquement
à Marseille, Trotsky et Natalia mettent pied à terre
dans le petit port de pêche de Cassis où un
commissaire de la Sûreté générale
notifie à Trotsky un permis de séjour en France qui
ne prévoit – agréable surprise – aucune restriction
ni aucune condition particulière ...
Ils en repartent aussitôt en voiture,
avec
un collaborateur de Raymond Molinier, Raymond Leprince et un jeune
étudiant militant, Jean de Lastérade, vers leur
destination finale en France, laquelle doit rester
secrète : il s'agit de Saint-Palais, près de
Royan, où ils arrivent dans l'après-midi du 25
après un repos d'une nuit dans la petite bourgade de
Tonneins. La villa qui va être le premier domicile
français de Trotsky en son dernier exil se trouve à
une dizaine de kilomètres au nord de Royan, au-dessus d'une
falaise et à proximité d'une plage. C'est une maison
isolée au milieu d'un grand jardin et qui, les jours
où l'océan est agité, justifie le nom qu'elle
porte : « Les Embruns ». Un incendie
provoqué par les flammèches échappées
d'une locomotive et qui a embrasé les broussailles proches,
retarde l'installation et inquiète les arrivants3. Mais l'anonymat a
été bien respecté et les traces
brouillées au débarquement : les envoyés
spéciaux des journaux parisiens se ruent pendant un temps
vers la petite station thermale de Royat où une «
fuite » a annoncé la présence de Trotsky
et où certains assureront même qu'ils l'ont
« vu » avec le dirigeant soviétique
Litvinov !
Jeanne et Véra Lanis, la compagne de
Raymond Molinier accueillent les nouveaux arrivants. Le lendemain,
Ljova se rend à Saintes pour accueillir Van à la
gare. C'est ce dernier qui règle, avec le préfet,
à La Rochelle, la question de la résidence
légale de Trotsky, laquelle doit, pour les uns et les
autres, demeurer secrète. Bientôt d'autres voyageurs
de Prinkipo, Rudolf Klement, puis Sara Weber, qui repartira
bientôt rejoindre son mari. Outre Jeanne et Véra,
chargées de la cuisine et du ménage, on a fait appel
à d'autres militants pour aider à assurer les gardes.
Yvan Craipeau, un des animateurs des Jeunesses de l'Opposition,
l'étudiant en médecine Jean de Lastérade, le
métallo Savall, le maître d'internat Jean Beaussier
viennent passer quelques semaines et prendre part aux
premières discussions sur le
« tournant ». Un peu plus tard arrive un
militant allemand originaire de Dantzig, Willy Schmuszkovitz, qui
enchante tous les hôtes de la maison par son talent de
pianiste.
Dès le 27 juillet, un débat a
été organisé, entre les camarades
présents, sur la nouvelle perspective. Van se souvient des
hésitations de Trotsky sur la question
« secondaire et subordonnée » du nom
de la future Internationale :
« Quatrième Internationale ? Ce n'est pas
très agréable. Quand on a rompu avec la
Deuxième Internationale, on a changé les fondements
théoriques. Ici, non, nous restons sur la base des quatre
premiers congrès. On peut aussi proclamer :
l'Internationale communiste, c'est nous ! Et nous appeler
Internationale communiste (bolcheviks-léninistes). Il y a du
pour et du contre. Le titre de Quatrième Internationale est
plus net. Il y a peut-être là un avantage pour les
larges masses. S'il s'agit de la sélection plus lente des
cadres, il y a probablement avantage de l'autre
côté : Internationale communiste
(bolcheviks-léninistes)4. »
Un extrait du procès-verbal de cette
réunion « familiale » est
publié dans un bulletin intérieur
ronéotypé de la section américaine.
Le débat est lancé dans toutes les
sections, et Trotsky, désormais, a la possibilité d'y
intervenir rapidement et même, à certains
égards, directement : c'est un avantage énorme
dont il éprouve beaucoup de satisfaction, bien que
l'opposition ne se manifeste pas avec une grande vigueur et que le
« tournant » soit finalement accepté
sans réelle difficulté par la majeure partie des
oppositionnels.
L'un des avantages de la résidence en
France est, bien entendu, que Trotsky peut maintenant rencontrer
militants et responsables, se former une opinion sans avoir besoin
d'un intermédiaire, convaincre par la parole au lieu
d'écrire, bref, avoir une action militante. Il faut
cependant prendre des précautions. Le P.C.F. est
menaçant. Dans L'Humanité du 25 juillet, on
parle du « boyard contre-révolutionnaire voyageant
avec sa valetaille » ; une légende le montre
« entouré de ses domestiques » ... Le 25, l'un
des rédacteurs les plus répugnants de
L'Humanité, P. Laurent-Darnar, a parlé du
« repaire » du « nouveau garde
blanc », tandis qu'un communiqué du bureau
politique a appelé toutes les organisations du parti
à « prendre toutes dispositions » pour
exprimer leur mépris « pour le
renégat » en réplique à sa
« provocation ». Parlant de l'arrivée
à Marseille, Laurent-Darnar assure : « M.
Trotsky, couvé par la flicaille de France, s'avère
agent méprisable du gouvernement5 » Il n'est
pas douteux que le P.C.F. peut un jour conduire à la
résidence des Trotsky, des agresseurs, voire des tueurs.
C'est cette préoccupation qui explique le
luxe de précautions pris pour le choix et l'acheminement des
visiteurs, militants ou personnalités
privilégiés que Raymond Molinier contacte à
Paris et dont il organise le voyage, sans que les
intéressés connaissent avant leur arrivée leur
destination exacte. Il y a bientôt plusieurs dizaines de
personnes qui sont ainsi dans la confidence et connaissent la
résidence de Trotsky. Il semble bien qu'aucune fuite ne se
soit pourtant produite, malgré des paniques soudaines et des
inquiétudes permanentes : la retraite de Saint-Palais
ne sera pas connue de la presse, ni du G.P.U., à qui cette
information fera d'ailleurs cruellement défaut, au moment de
la préparation des procès de Moscou.
C'est Trotsky qui est, au premier chef,
responsable des imprudences commises dans ce domaine, mais qui se
révéleront finalement sans conséquence. Il
insiste beaucoup auprès de ses jeunes camarades pour
être mis en contact direct avec des militants communistes,
oppositionnels ou susceptibles de le devenir, appartenant à
la base, des « ouvriers », y compris, bien
entendu, et même surtout quand ils sont encore membres du
Parti communiste. Parmi les visiteurs de la maison, on compte des
oppositionnels comme l'ostréiculteur Courdavault,
d'Oléron, le cheminot du Blanc Louis Saufrignon, le
plombier, devenu jardinier, Mary Philippe, l'instituteur Roger
Turquois, mais aussi des militants ordinaires du P.C. comme le
chauffeur de taxi Cureaudeau et le marchand de vélos Jean
Gourbil.
Le gros des visiteurs est composé
cependant
par les militants des diverses organisations de l'opposition. Ils
viennent d'abord pour de simples rencontres, des réunions
d'éclaircissements, puis pour des discussions et des
concertations. L'Opposition française, la Ligue communiste
et, avec elle, l'Opposition internationale, connaissent une
nouvelle crise avec les réserves, puis l'hostilité
déclarée au tournant du « groupe
juif » parisien que va bientôt appuyer un
dirigeant de la Nouvelle Opposition Italienne (N.O.I.), Mario
Bavassano, dit Giacomi, un ancien de l'appareil militaire de l'I.C.
Ils sont soutenus en sous-main par le secrétaire
international (du S.I.) le Grec Yotopoulos-Vitte, et rompent en
octobre pour constituer l'Union communiste à laquelle ils
ont rallié quelques-uns des premiers visiteurs de Trotsky,
Lastérade, Beaussier et Savall notamment.
On voit donc beaucoup de monde aux
Embruns. A part
Raymond Molinier et Ljova qui vont et viennent, la
quasi-totalité des militants parisiens importants,
Français ou étrangers, viennent séjourner ou
seulement passer. On voit Frankel, l'Allemand Bauer (Ackerknecht),
l'Italien Blasco (Tresso) et son compatriote Leonetti, tous trois
figures de proue du secrétariat international, les Belges
Léon Lesoil, géomètre des mines et Georges
Vereeken, chauffeur de taxi, tous les deux anciens membres du
comité central du Parti communiste belge, le jeune Suisse
Walter Nelz (Ost) venu de Zurich à bicyclette6, le tout jeune
Allemand Walter Held, de passage entre Prague et Amsterdam, Pierre
Naville, bien entendu, l'Allemand Karl Erde, doublement clandestin,
dans la société et dans le K.P.D., ancien responsable
du M. Apparat, l'appareil militaire du
parti allemand.
Il vient aussi une délégation du « groupe
juif », dont nous ne connaissons pas la composition, et le
jeune Torielli qu'on appelle Pierre Rimbert, qui a quitté la
Ligue et combat le tournant, et l'un des militants ouvriers du
Nord, Eugène Devreyer.
D'autres militants viennent pour des
raisons
teehniques. Le docteur Breth, l'oncle de Jirf Kopp, est venu de
Reichenberg faire un bilan de la santé de Trotsky et
éclaircir, si possible, la question de ses accès de
fièvre. Le coiffeur René Lhuillier vient de Paris
pour lui couper les cheveux. Jean Meichler et Henri Molinier, comme
Maurice Segal et Raymond Leprince, collaborateurs de Raymond
Molinier dans les affaires, sont souvent là aussi, en
qualité de chauffeurs ou pour des tâches
matérielles qui ne manquent pas.
Au moment de la conférence de Paris –
dont il sera question dans un chapitre particulier – c'est un
défilé, à Saint-Palais, de
représentants des différentes organisations
socialistes de gauche, avec plusieurs responsables de l'I.L.P.
(Independent Labour Party) britannique, Jennie Lee, John Paton,
C.A. Smith, les Néerlandais de l'O.S.P. (Parti socialiste
indépendant), Jacques de Kadt et P.J. Schmidt, et, venu
seul, le dirigeant du R.S.A.P. (parti révolutionnaire
socialiste ouvrier) néerlandais, Henk Sneevliet, et celui du
Parti socialiste ouvrier allemand, le S.A.P., Jakob Walcher, vieux
militant syndical massif et solide ; un peu plus tard, c'est
l'économiste du S.A.P., Fritz Sternberg, avec qui Trotsky
discute pendant plusieurs jours de la situation mondiale.
André Malraux vient le 7 août ;
les deux hommes ont deux entretiens successifs et parcourent
ensemble les vastes horizons. Sur la base des
éléments donnés par Malraux, van Heijenoort et
Jean Beaussier, Gérard Roche a fait une mise au point :
les deux hommes ont parlé de l'art, du cinéma et de
la danse, du christianisme, des rapports entre communisme et
individualisme, de la campagne de Pologne en 1921, de la situation
mondiale, de la mort – dans laquelle Trotsky voit
« un décalage d'usure, celle du corps et celle de
l'esprit », sans quoi il n'y aurait pas de
résistance et la mort serait simple7.
Trotsky reçoit aussi la visite de Maurice
Parijanine, le traducteur en français des grandes
œuvres du début de l'exil, celle de l'ingénieur
américain John Becker, qui est devenu l'un des principaux
agents d'information et de liaison de Sedov avec l'U.R.S.S. Un
autre visiteur est Julian Gumperz, ex-militant du parti allemand,
candidat au financement d'une revue commune des groupes
d'opposition.
Un élément nouveau dans la vie de
Trotsky à cette époque, c'est la
détérioration de ses relations, tant personnelles que
politiques, avec Raymond Molinier, et la crise sérieuse qui
les oppose. D'abord parce que Molinier a eu une attitude
ambiguë avec les adversaires du tournant. Ensuite parce que
Trotsky est informé pour la première fois
concrètement, par un homme en qui il a toute confiance,
l'Italien Blasco, de la nature – violences et
chantage – des méthodes employées, pour
faire de l'argent, par l'Institut français de recouvrement
qui est le bastion des « affaires » de
Molinier.
Guéri de son lumbago, Trotsky connaît
à Saint-Palais quelques semaines de très bonne
santé et d'activité intense. Il sort peu cependant,
seulement pour de brèves promenades en voiture sur les
chemins entre les vignes. Mais il passe plus de temps dans le
jardin où il joue beaucoup avec les deux bergers allemands
amenés par Raymond Molinier pour la garde, Benno et Stella.
A la fin d'août pourtant, il est repris par de nouveaux
accès de la fièvre mystérieuse dont il n'a
jusqu'à présent souffert que dans les moments de
tension, au cours de batailles politiques intenses. Il passe des
journées entières au lit, ruisselant de sueur, et
écrit à Natalia, partie quelques semaines pour se
soigner et visiter des amis, des lettres plutôt
mélancoliques.
C'est avec joie qu'il a retrouvé Ljova,
à cause de qui il a vécu, sans le dire, des mois
d'angoisse, dans les derniers temps de son séjour allemand
et après la mort de Zinaida. Les retrouvailles ont
sérieusement rapproché le père et le fils,
dont l'accord politique sur le tournant et ses conséquences
semble avoir été total, par-dessus le marché.
Le 19 septembre 1933, à la veille du départ de Ljova
pour Paris, Trotsky écrit à Natalia cet
émouvant aveu :
« Je
regrette que Ljova s'en aille ; ici, on me traite très
bien, mais, tout de même, il n'y a personne qui soit tout
à fait mien8. »
C'est Ljova qui soulève, dans une des
lettres échangées à la hâte entre les
deux hommes pendant l'été, la nécessité
d'une clarification de ce qu'il appelle « la question
russe », loin, selon lui, d'avoir été
réglée par l'affirmation de la
nécessité d'un « nouveau parti
bolchevique ». La formation en U.R.S.S. d'un nouveau
parti n'implique-t-elle pas la perspective d'une
« nouvelle révolution » ? Ne
faudra-t-il pas arracher par la force le pouvoir à la
bureaucratie, même s'il ne s'agit pas d'une révolution
sociale ? Ne serait-il pas nécessaire, à la
lumière de la nouvelle orientation, de revenir sur la
question de la nature sociale de l'Union soviétique pour
aider les militants qui, sur ce point au moins, ne voient plus
clair9 ?
Trotsky, pendant ces semaines, a
finalement
tranché la question de ce que sera son prochain travail et
s'est décidé pour un Lénine qui devrait
être l'œuvre de sa vie. Il a commencé à
rassembler des matériaux et à penser à
l'architecture générale de l'œuvre, mais se
rend aux arguments de Ljova, sans résistance, et consacre
les dernières semaines de son séjour à
Saint-Palais – les heures du moins où la fièvre
l'épargne – à l'élaboration du travail
que lui a demandé Ljova et qu'il titre « La
IVe Internationale et l'U.R.S.S. La
nature de classe de l'Etat
soviétique10. »
Polémiquant un peu tous azimuts –
contre Lucien Laurat, Simone Weil, Urbahns et tous les anciens
communistes qui s'efforcent peu ou prou de donner une
définition nouvelle de la nature de l'Etat
soviétique, il place au centre de son analyse celle de la
bureaucratie dont il considère qu'elle n'est pas une classe
et que son monopole du pouvoir en U.R.S.S. ne modifie pas le
caractère social « ouvrier » des bases
de l'économie et de la société dans ce pays.
Il écrit :
« La
classe, pour un marxiste, représente une notion
exceptionnellement importante et d'ailleurs scientifiquement
définie. La classe se détermine non pas seulement par
la participation dans toute la distribution du revenu national,
mais aussi par un rôle indépendant dans la structure
générale de l'économie, par des racines
indépendantes dans les fondements économiques de la
société. Chaque classe (féodaux, paysannerie,
petite bourgeoisie, bourgeoisie capitaliste, prolétariat)
élabore ses formes particulières de
propriété11. »
Or la bureaucratie ne présente, selon
lui,
aucun des traits sociaux qui permettent de la considérer
comme une classe :
« Elle n'a pas
de place indépendante dans le processus de production et de
répartition. Elle n'a pas de racines indépendantes de
propriété. Ses fonctions se rapportent, dans leur
essence, à la technique politique de la domination
de
classe. La présence de la bureaucratie, avec toutes les
différences de ses formes, et de son poids
spécifique, caractérise tout régime de
classe. Sa force est un reflet. La bureaucratie, indissolublement
liée à la classe économiquement dominante, est
nourrie par les racines sociales de celle-ci, se maintient et tombe
avec elle12. »
A ceux qui, comme Lucien Laurat,
s'appuient sur le
fait que la bureaucratie dévore une part importante du
revenu national, pour la définir comme une nouvelle
« classe exploiteuse », Trotsky répond
que la bureaucratie existe aussi dans les pays capitalistes
où elle engloutit aussi une part importante du revenu
national, sans constituer pour autant une classe
indépendante de la classe dominante. Sur la bureaucratie
stalinienne, il écrit :
« Elle
engloutit, dissipe et dilapide une partie importante du bien
national. Sa direction revient extrêmement cher au
prolétariat. Elle occupe une situation extraordinairement
privilégiée dans la société
soviétique, non seulement au sens de droits politiques et
administratifs, mais aussi au sens d'énormes avantages
matériels. Cependant les appartements les plus grands, les
beefsteaks les plus saignants et même les Rolls-Royce ne
font pas encore de la bureaucratie une classe dominante
indépendante13. »
Après avoir souligné que
l'inégalité sociale est une forme inévitable
dans un régime de transition de
« l'héritage monstrueux du
capitalisme », il écrit :
« La
bureaucratie ébranle les attaches morales de la
société soviétique, engendre un
mécontentement aigu et légitime des masses et
prépare de grands dangers. Néanmoins, les
privilèges de la bureaucratie en eux-mêmes ne changent
pas encore les bases de la société soviétique,
car la bureaucratie tire ses privilèges, non de certains
rapports particuliers de propriété, propres à
elle, en tant que "classe", mais des rapports mêmes de
possession qui furent créés par la révolution
d'Octobre14. »
Sur l'analyse de l'Union soviétique dans
son état du moment, il conclut :
« Quand la
bureaucratie, pour parler simplement, vole le peuple ..., nous
avons affaire non pas à une exploitation de classe,
au sens scientifique du terme, mais à un parasitisme
social, quoique sur une très grande échelle15. »
Pour être parfaitement clair avec les
perspectives, il ajoute :
« Si
aujourd'hui en U.R.S.S. apparaissait au pouvoir un parti marxiste,
il restaurerait le régime politique, changerait, purifierait
et dompterait la bureaucratie par le contrôle des masses,
transformerait toute la pratique administrative, introduirait une
série de réformes capitales dans la direction de
l'économie, mais en aucun cas il n'aurait à accomplir
un bouleversement dans les rapports de propriété.
c'est-à-dire une nouvelle révolution sociale16. »
L'appareil stalinien défend certes le
régime né d'octobre, qui est la source de ses
privilèges, par ses méthodes propres, mais il en
prépare l'effondrement avec l'étranglement du parti
et des syndicats qui signifient l'atomisation du
prolétariat, l'étouffement administratif des
antagonismes sociaux. A l'avenir, la véritable guerre civile
pourrait éclater, « non pas entre la bureaucratie
stalinienne et le prolétariat », mais entre
« le prolétariat et les forces actives de la
contre-révolution » et ce serait alors la
victoire du parti prolétarien sur la
contre-révolution qui assurerait l'élimination de la
bureaucratie.
Trotsky ne croit pas à la
possibilité pour le pouvoir soviétique de se
maintenir longtemps sur la base des seules forces de classe
intérieures : l'avenir de l'U.R.S.S., il le
répète encore, dépend de la victoire de la
révolution mondiale – et la victoire de celle-ci
dépend de la formation de nouveaux partis communistes et de
la nouvelle Internationale qu'il s'est décidé
à appeler « IVe
Internationale ».
C'est cette dernière qui constitue pour
lui
la clé de l'avenir, y compris du destin de l'Union
soviétique :
« Le jour
où la nouvelle Internationale montrera aux ouvriers russes
non pas en paroles, mais dans l'action, qu'elle est, et elle seule,
pour la défense de l'Etat ouvrier, la situation des
bolcheviks-léninistes à l'intérieur de l'Union
soviétique changera en vingt-quatre heures. La nouvelle
Internationale proposera à la bureaucratie stalinienne le
front unique contre les ennemis communs. Et si notre Internationale
représente en soi une force, la bureaucratie ne pourra pas,
à la minute du danger, se refuser au front unique. Que
restera-t-il alors des mensonges et des calomnies accumulés
pendant de nombreuses années17? »
Cette mise au point sur l'Union
soviétique,
réclamée par Ljova, vient clore pratiquement la
période de Saint-Palais.
Nous avons peu d'éléments sur le
voyage qui a suivi l'été de Saint-Palais, une
détente recommandée par les médecins et
souhaitée vivement par Natalia et L.D. comme un
séjour à deux dans la solitude. Revenue de Paris en
voiture le 8 octobre avec Henri et Raymond Molinier, Natalia
retrouvait un L.D. qui n'avait pas encore changé son aspect
physique pour s'assurer l'anonymat dans leur escapade. Ce n'est que
le 9 au matin, après avoir renoncé à se
teindre les cheveux, que Trotsky rasa lui-même sa barbiche,
ce qui, effectivement, le rendait difficilement reconnaissable.
A 11 heures du matin, le couple Trotsky
prend la
route, avec Henri Molinier et Jean Meichler. Ils arrivent à
Bordeaux à 16 heures et s'y arrêtent, du fait d'une
avarie de moteur : ils vont coucher à l'hôtel
Faisan, place de la Gare. Après une vaine attente pour la
réparation de la voiture, les voyageurs se décident
à en louer une autre et repartent le 11 octobre, passant la
nuit à Mont-de-Marsan. Ce n'est que le 12 qu'ils arrivent
à Bagnères-de-Bigorre. Henri Molinier, reparti pour
Paris, est remplacé par Jeanne, qui arrive le 17 octobre.
Nous savons que Trotsky continue de lire les journaux, mais
s'abstient totalement d'écrire. Nous savons qu'ils ont fait
une excursion à Lourdes, ce qui l'amènera à
écrire un peu plus tard dans son Journal d'Exil :
« Quelle
grossièreté, quelle impudence, quelle vilenie !
Un bazar aux miracles, un comptoir commercial de grâces
divines. La grotte elle-même fait une impression
misérable. C'est naturellement là le calcul
psychologique des prêtres : ne pas effrayer les petites
gens par les grandioses dimensions de l'entreprise
commerciale : les petites gens craignent une vitrine trop
magnifique. En même temps, ce sont les plus fidèles et
les plus avantageux acheteurs. Mais le meilleur de tout, c'est
cette bénédiction du Pape, transmise à
Lourdes... par la radio. Pauvres miracles
évangéliques, à côté du
téléphone sans fil !.. Et que peut-il y avoir de
plus absurde et de plus repoussant que cette combinaison de
l'orgueilleuse technique avec la sorcellerie du super-druide de
Rome ! En vérité, la pensée humaine est
embourbée dans ses propres excréments18. »
Après ce séjour de repos, les
voyageurs, toujours accompagnés de Meichler, prennent le 31
octobre l'autobus du retour pour Tarbes et, de là, pendant
la nuit, le train pour Orléans où Raymond Molinier
les attend en voiture. Tandis que Jean Meichler continue sur Paris,
Raymond conduit les deux voyageurs à Barbizon, dans la villa
louée pour eux par Henri Molinier, qui les attend sur place
avec Van, le 1er novembre 1933.
C'est encore Van qui décrit la maison,
aujourd'hui démolie, à la lisière de la petite
ville de Barbizon, en Seine-et-Marne, à une cinquantaine de
kilomètres de Paris, connue par ses peintres et
extrêmement calme alors. Il écrit :
« Henri
Molinier avait loué une villa qui se trouvait sur un petit
chemin longeant la forêt. La villa Ker-Monique avait deux
étages ; les pièces étaient petites, les
escaliers et les couloirs étroits. Nous nous sentions
entassés dans cette maison, ce n'était plus l'espace
de Prinkipo ou de Saint-Palais. La chambre et le bureau de Trotsky
étaient au premier étage. Le jardin n'était
pas grand. La villa n'était guère qu'un pavillon de
banlieue, mais l'endroit était calme19. »
L'immense supériorité de la nouvelle
demeure est évidemment dans sa proximité de Paris et
la grande facilité des déplacements, en voiture ou en
autobus, qui permettent d'éviter les foules des gares de
chemin de fer. Du coup, le mode de vie est presque à
l'opposé de celui de Saint-Palais. Il n'y a plus de
visiteurs, même camarades. La population permanente de la
maison est composée de L.D. et Natalia, Rudolf Klement, Sara
Weber, Jean van Heijenoort et sa compagne, Gaby Brausch, qui
s'occupe de la cuisine et du ménage avec Natalia, et avec
l'aide, une fois par semaine, de Barbara, de son vrai nom Deborah
Seidenfeld-Stretielski, compagne de Blasco, appelée «
la Blascotte ». En février, il faut tout
réorganiser. Sara Weber est rentrée
précipitamment aux Etats-Unis. Van et Gaby vont se fixer
à Paris où les attendent des tâches politiques.
A leur place viennent s'installer Otto Schüsster et sa femme
Gertrud Schröter ; un militant polonais, Max Gavenski,
vient de temps en temps pour dactylographier en russe20.
Les seuls visiteurs sont des visiteurs
réguliers : Henri Molinier, qui connaît la villa
puisqu'il l'a trouvée et louée, Ljova et Jeanne qui
viennent le plus souvent en voiture, afin de mieux repérer
et semer d'éventuels suiveurs indiscrets. Trotsky ne se
prive pas de prendre personnellement des contacts. Seulement c'est
lui qui se déplace désormais, une fois, parfois deux
fois par semaine, pour se rendre à Paris, à des
rendez-vous arrangés pour lui par Ljova.
Dans les cas les plus importants, les
rencontres
ont lieu dans l'appartement de Gérard Rosenthal, mais il a
également des rendez-vous dans certains cafés de la
porte d'Italie, à d'autres domiciles privés et
même dans le local de la Ligue communiste, où, sans
être vu, grâce à des portes entrouvertes, il
assiste à des discussions politiques qui lui apprennent
beaucoup.
Il n'est sans doute pas possible de
dresser la
liste complète de ses rencontres. Du mouvement oppositionnel
il a voulu connaître les provinciaux et
particulièrement les ouvriers du Nord Albert Cornette,
Devreyer. Il a des réunions avec le secrétariat
international, celui de la Ligue française, et celui de
l'organisation allemande où il rencontre pour la
première fois le jeune Allemand des Sudètes Erwin
Wolf.
Pour les autres, il faut se contenter
d'énumérer les personnes mentionnées dans la
correspondance de Sedov. La députée communiste
allemande Maria Reese, amie d'Ernst Torgler, responsable de la
fraction K.P.D. au Reichstag, en train de rompre avec ce dernier
parti. L'ancienne secrétaire de Rosa Luxemburg, Fania
Jezerskaia, qui offre ses services techniques. L'homme d'affaires
du pays sudète Friedrich Bergel, qui finance le mouvement et
y milite aussi sous le nom de Barton. L'avocat Otto Neustedtl, dit
Erich Löffler, du même groupe de Reichenberg, le
« groupe Rops », formé d'hommes de
professions libérales qui collectent beaucoup d'argent. Le
vieux militant communiste juif Hershl Mendel Sztokfisz, venu de
Pologne, où il est l'un des dirigeants de l'Opposition. Le
député socialiste belge Paul-Henri Spaak, leader de
la gauche du parti ouvrier (P.O.B.). Le journaliste Willi Schlamm a
ouvert à Trotsky la porte du prestigieux hebdomadaire
allemand de Prague, Neue Weltbühne. Ce dernier va
aussi
rencontrer à sa demande le jeune socialiste italien Carlo
Rosselli, fondateur et dirigeant du mouvement Giustizia e
Libertà , les anciens dirigeants du K.P.D. et de la
Gauche allemande, Ruth Fischer et Maslow, et son ancien
secrétaire à Prinkipo, Robert Ranc. Des
personnalités de « gauche » du
mouvement ouvrier français, comme Simone Weil et Daniel
Guérin. On peut ajouter à cette liste les noms des
visiteurs étrangers membres de l'opposition, comme le jeune
Belge Georges Fux ou l'Américain Albert Glotzer.
Certaines de ces rencontres ont été
couronnées de succès. Trotsky certes n'a convaincu
– le voulait-il ? – ni Paul-Henri Spaak ni Carlo
Rosselli, mais il a décidé au travail en commun et
Ruth Fischer et son compagnon Maslow. Il a gagné à sa
fraction l'Allemande Maria Reese et convaincu de la justesse du
« tournant » le vétéran venu de
Pologne. Cette activité, ses succès personnels
contribuent sans doute beaucoup à son moral : pour la
première fois depuis des années, il occupe un poste
qui lui permet de contribuer directement et personnellement
à la construction de l'organisation, de payer de sa
personne, de collaborer directement à la marche en
avant.
Cette situation était-elle durable ? On
peut en douter. Les adversaires de Trotsky ne le lâchaient
pas des yeux. Au lendemain des violentes manifestations communistes
du 9 février 1934, la presse hitlérienne
lançait une violente campagne contre lui, le
présentant comme l'instigateur des « troubles et
de l'agitation » en France. Son ancien secrétaire
Jan Frankel, avec qui il était en contact suivi et qu'il
avait chargé d'explorer les possibilités d'un
« travail de fraction » à
l'intérieur de la S.F.I.O., reconnu par un policier parmi
les manifestants du 12 février à Paris, fut
aussitôt expulsé de France. Le cercle, en fait, se
resserre sur lui.
De la part du gouvernement français,
Trotsky ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ferme
les yeux sur son activité, aussi discrète soit-elle,
comme l'ont fait les gouvernements à direction radicale qui
se sont succédé depuis son arrivée en France.
Après la démission de Daladier, au lendemain de
l'émeute des Ligues, le 6 février 1934, l'ancien
président de la République Gaston Doumergue a
constitué le 9 février un « gouvernement
d'union » qui ne comprend, bien entendu, ni socialistes
ni communistes. Le maréchal Pétain est ministre
d'Etat ; le ministre de l'Intérieur est Albert Sarraut,
radical, auteur de la célèbre formule :
« Le communisme, voilà l'ennemi. »
L'aggravation des tensions politiques et sociales rend l'asile de
Trotsky de plus en plus précaire.
Il restait encore à Trotsky à vivre
à Barbizon un épisode particulièrement
douloureux pour lui : la double capitulation des derniers des
« vieux » de l'opposition maintenus en
déportation par Staline, L.S. Sosnovsky, dont la lettre de
renonciation – un authentique reniement –
parut dans la Pravda du 9 février et surtout
Khristian Georgévitch Rakovsky, dont le
télégramme fut publié le 20 février.
Immédiatement prévenu, Trotsky fait, dès le 21
février, une déclaration sur la capitulation de son
vieil ami. Il écrit :
« Rakovsky n'a
nullement "capitulé" dans le sens de Zinoviev, Kamenev et
consorts. Il n'a pas renié un seul mot des idées au
nom desquelles il combattait avec nous. Il n'a pas reconnu de
prétendues fautes commises par l'Opposition de gauche. Il
n'a pas proclamé la justesse de la politique dirigeante.
Dans les conditions de l'U.R.S.S. que nous connaissons tous, ce
trait essentiel de la déclaration de Rakovsky est d'une
éloquence exceptionnelle. Il ne fait qu'accentuer le fait
que Rakovsky, théoriquement et politiquement, n'a rien
à abdiquer ni à abjurer de son passé.21 »
Rakovsky déclare arrêter un combat
qu'il avait en fait cessé depuis des années, dans un
isolement absolu et sans aucune perspective. Il faut bien entendu,
selon Trotsky, non seulement regretter, mais condamner cette
déclaration. Mais c'est peut-être avec un certain
soulagement qu'il écrit :
« Nous
enregistrons la déclaration purement formelle du vieux
lutteur qui, par toute sa vie, a montré son
dévouement inébranlable à la cause
révolutionnaire, nous l'enregistrons avec douleur et nous
passons à l'ordre du jour, c'est-à-dire la lutte
doublement vigoureuse pour de nouveaux partis de la nouvelle
Internationale.22 »
En fait, Trotsky a été abusé
par l'extrait publié, peut-être à dessein, du
télégramme de son ami, et il est difficile,
après la publication du texte intégral de la
déclaration de Rakovsky dans les Iszvestia du 23
février, d'écrire qu'il ne s'agit pas d'une
« capitulation » : c'est probablement pour
cette raison que, fait sans précédent, The
Militant du 10 mars publie le texte amputé de ses deux
premiers paragraphes.
Trotsky n'a maintenant plus d'illusions.
Le 19
mars 1934, il écrit à son fils :
« Au moment même de la victoire de Hitler en
Allemagne, nous
allions répétant – et avons répété ensuite plus d'une fois – que sans
succès de la révolution en Occident, le régime bureaucratique sur le
terrain du socialisme national ne pourrait que se renforcer en U.R.S.S.
Les quinze mois écoulés ont confirmé cette prévision. La reddition de
Rakovsky et de Sosnovsky représente l'une des manifestations de la
réaction nationale ou plutôt du désespoir international. On ne peut
tenir les positions des communistes internationalistes aujourd'hui que
si l'on garde sous les yeux la perspective mondiale. ... Les
anciens oppositionnels en U.R.S.S. étaient hermétiquement coupés de ces
perspectives. Leur capitulation est bien entendu pour nous un certain
coup moral, mais si l'on pense à toute l'affaire et à la situation
individuelle de chacun d'eux vivant littéralement dans une bouteille
cachetée – on n'a jamais rien vu de semblable dans l'histoire mondiale
du mouvement révolutionnaire –, alors on sera forcément plutôt étonné
qu'ils aient tenu ou tiennent sur leur position jusqu'à
maintenant 23. »
Le 31 mars, il revient en public sur la
question
et, après avoir fait quelques points d'histoire et
rappelé les conditions de détention de Rakovsky, il
poursuit :
« La déclaration de Rakovsky est l'expression d'un
désespoir et
d'un pessimisme subjectif. Est-il possible de lutter pour le marxisme
quand la réaction triomphe sur toute la ligne ? On peut, sans aucune
exagération, dire que c'est grâce à Hitler que Staline a vaincu
Rakovsky. Cependant cela signifie seulement que la voie choisie par
Rakovsky conduit au néant politique. ... En Rakovsky, nous
regrettons l'ami politique perdu. Mais nous ne nous sentons pas
affaiblis par sa défection, laquelle, bien qu'elle constitue une
tragédie personnelle, apporte une confirmation politique irréfutable de
la justesse de notre analyse. L'Internationale communiste est morte en
tant que facteur révolutionnaire. Elle n'est capable que de corrompre
les idées et les caractères.24 »
Le coup est pourtant très dur avec la
disparition de l' « ami de trente ans »,
irrémédiablement perdu, dont Trotsky entrevoit
peut-être, sans l'imaginer vraiment, le sort tragique qui
sera le sien.
C'est en tout cas un signe infaillible de
la
profondeur de sa douleur que l'ordre donné à Van,
quelques jours plus tard, de brûler, avec de vieux papiers,
la photo de « Rako » déporté,
envoyée par ce dernier en 1932 : « Tenez, vous pouvez
brûler cela aussi 25. »
Dans son
Journal d'Exil,
à la date du 25 mars 1935, il écrit avec une totale
lucidité :
« Rakovsky
était au fond mon dernier lien avec l'ancienne
génération révolutionnaire. Après sa
capitulation, il n'est resté personne. Bien que ma
correspondance avec Rak-ovsky eût cessé – pour
raisons de censure – à partir de mon exil,
néanmoins, la figure de Rakovsky était restée
un lien en quelque sorte symbolique avec les vieux compagnons de
lutte. Maintenant il ne reste personne. Le besoin d'échanger
des idées, de débattre ensemble des questions, ne
trouve plus, depuis longtemps, de satisfaction. Il ne reste
qu'à dialoguer avec les journaux, c'est-à-dire
à travers les journaux, avec les faits et les opinions.26 »
C'est, semble-t-il, accidentellement,
qu'a
éclaté, en avril 1934, « l'affaire
Trotsky », même si son développement et son
exploitation n'ont pas relevé du hasard. Au point de
départ, il y a d'abord là curiosité, voire
l'inquiétude, provoquées à Barbizon, toute
petite ville, par des hôtes bizarres ayant des accents
étrangers, qui vivent repliés sur eux-mêmes,
boivent beaucoup de lait et ne fréquentent guère la
population locale. On murmure qu'il s'agit de trafiquants, voire de
faux-monnayeurs, on parle de « drogue » et de
« traite des blanches ». Les gendarmes de la
brigade de Ponthierry – dont Barbizon dépend –
sont alertés, intrigués à leur tour. Ils
commencent à exercer sur les habitants de la villa une
surveillance discrète, attendant patiemment un
prétexte pour une intervention qui leur permettrait d'en
savoir plus 27.
L'occasion leur en est fournie par une
double
négligence de Rudolf Klement. Circulant sans
éclairage sur son vélomoteur dans la soirée du
12 avril, il est interpellé par les gendarmes de Ponthierry
et ne peut produire de papiers d'identité ; il est
alors gardé à vue dans les locaux de la gendarmerie
où l'on examine avec intérêt et stupeur les
documents dont il est porteur, à savoir le courrier de
Trotsky adressé à Trotsky ou Sedov, à la poste
restante de la rue du Louvre à Paris, d'où il
revient. Des lettres de, Bruxelles, concernant le travail russe,
d'Athènes, de Plzen, des Etats-Unis, des bulletins
intérieurs divers, « des documents
volumineux » en russe 28. C'est plus
qu'il n'en faut.
Aucun doute n'est possible pour les
gendarmes de
Ponthierry : ils ont mis la main sur le repaire de Trotsky.
Alerté par leurs soins, le procureur de la République
de Melun s'adresse immédiatement au contrôleur
général des services administratifs, au
ministère de l'Intérieur, afin de savoir dans quelles
conditions exactes Trotsky a été autorisé
à résider en France. Malveillant ou mal
informé, le fonctionnaire qu'il obtient au
téléphone lui assure que Trotsky a bel et bien
été autorisé à résider en France
pour raisons de santé, mais à la condition expresse
de s'établir en Corse. Cette information est fausse, et
plusieurs hauts responsables de la police sont parfaitement
informés de sa résidence à Barbizon –
à laquelle ils ont donné leur accord, l'ensemble des
négociations ayant été menées entre
Henri Molinier et un haut fonctionnaire de la Sûreté
générale, Henri Cado. Mais aucun des fonctionnaires
informés ne démentira publiquement la version
invoquée de l'infraction à la résidence
autorisée en Corse seulement.
Pendant la nuit, des conversations
téléphoniques entre le procureur
général, le préfet de Seine-et-Marne et de
hauts responsables de la Sûreté générale
aboutissent à la décision d'organiser une descente de
justice à la villa Ker-Monique, pour s'y assurer de
l'identité de ses habitants, dans le cadre d'une information
ouverte pour la circonstance, contre Klement « et
autres », pour « vol, complicité et
recel ». Interrogé par le procureur, Trotsky
dément avec indignation la version de l'autorisation de
séjour limitée à la Corse. Peu importe
cependant que le procureur le croie ou ne le croie pas,
vérifie ou ne vérifie pas au bon endroit, à la
Sûreté générale. Il est trop tard :
prévenus par l'écrivain André Billy, les
reporters de la grande presse s'abattent sur Barbizon. Il est
désormais difficile, pour des fonctionnaires couards, de
rétablir la vérité, et ils ne la
rétabliront pas.
Trotsky racontera avec humour, un an plus
tard, ce
qu'il appelle alors « l'assaut des pouvoirs à
Barbizon » :
« Ce fut le plus comique quiproquo qu'on puisse
imaginer.
L'opération était dirigée par Monsieur le procureur de la République de
Melun – un haut personnage du monde de la justice – accompagné l'un
petit fonctionnaire du tribunal, d'un greffier écrivant à la main, d'un
commissaire de la Sûreté générale, de mouchards, de gendarmes, de
policiers, au nombre de plusieurs dizaines. L'honnête Benno, la
molosse, tirait éperdument sur sa chaîne. Stella lui faisait écho de
derrière la maison. Le procureur me déclara que toute cette armée était
venue à cause ... d'une motocyclette volée. ... II était bien
le
procureur de la République ! Ces hauts dignitaires, il ne faut jamais
les regarder de trop près. II s'était présenté chez moi, soi-disant
pour une affaire de motocyclette volée ..., mais me demanda
d'emblée quel était mon vrai nom. ... De tous ces visiteurs,
seul
le greffier, un vieil homme, donnait une impression sympathique. Quant
aux autres 29
... »
Le procureur constate que le passeport de
Trotsky
comporte la mention « autorisé à
résider en Seine-et-Marne » apposée par la
Sûreté générale, et le précise
dans son rapport. La presse, elle, se déchaîne :
Trotsky a reçu le procureur avec deux revolvers sur son
bureau, s'est vanté d'être « un vieux
conspirateur », parle de « la vie
étrange dans la maison », de son activité
en faveur de la IVº Internationale, preuve qu'il poursuit sur
le territoire français des activités politiques
incompatibles avec son statut d'étranger ! Le comble de
la lâcheté est atteint quand, le même 16 avril,
sur proposition du ministre de l'Intérieur Albert Sarraut,
le Conseil des ministres décide d'annuler l'autorisation de
séjour en France de Trotsky, « ce dernier n'ayant
pas observé les devoirs de neutralité politique comme
il s'y était engagé au moment où on lui
accordait l'hospitalité en France 30.
Ainsi se termine ignominieusement le
« séjour libre » de Trotsky en France
démocratique, par une décision qui satisfait la
presse nazie. Van a raconté les derniers jours à
Barbizon, le départ clandestin de Trotsky, dans la
soirée du 15 avril et son installation secrète dans
un pavillon de Lagny, loué par Sedov à titre de
précaution, le siège de
« Ker-Monique » par les journalistes auxquels
il donne le change, son opération d'intoxication des
inconnus qui ont mis sur écoutes le téléphone
de la maison. Il raconte aussi la foule haineuse du dimanche, les
forcenés qui tentent d'escalader la grille et hurlent leurs
menaces : il confesse que, pendant toutes les années
vécues près de Trotsky, c'est seulement en ces jours
qu'il eut peur 31.
Le gouvernement français s'est mis dans
une
situation difficile. Il cherche un compromis. Formellement
expulsé, Trotsky ne le sera pas en fait et ne sera pas non
plus interné. Après avoir, semble-t-il,
envisagé de l'envoyer à Madagascar ou à la
Réunion, le gouvernement Doumergue décide qu'il
pourra rester sur le territoire dans des conditions
agréées par les autorités qu'elles lui
laissent proposer lui-même.
Expulsé juridiquement sans l'être
physiquement, vivant en France sans visa, privé de
ressources et de toute possibilité d'en appeler à une
opinion publique intoxiquée par les clameurs chauvines qui
dénoncent en lui l'homme couvert de sang qui a
« trahi » les Alliés à
Brest-Litovsk, il n'a jamais été aussi démuni
et presque sans défense.
Il ne baisse pourtant pas les bras.
2
Van,
op. cit., pp. 77-78.
4
Ibidem, pp. 82-83.
5
L'Humanité, 25 juillet 1933.
7
G. Roche, « Malraux et
Trotsky », Cahiers Léon Trotsky nº 31,
1987, pp.
103-115.
8
Trotsky à N. Sedova, 19
septembre 1933, E.H. Carr., p. 56.
9
Sedov à Trotsky, 21 août
1933, A.H.F.N.
10
« La Nature de Classe de
l'Etat soviétique », B.O., nº 36/37,
octobre 1933, pp. 112. Œuvres, 2, pp.
243-268.
18
Journal
d'Exil, Paris, 1960, 29
avril 1935, p. 122.
21
Trotsky,
« Déclaration », 21 février
1934, Œuvres, 3, pp. 237-238.
23
Trotsky à Sedov, 19 mars 1934,
A.H.F.N.
24
« Que signifie la
capitulation de Rakovsky ? », 31 mars 1934, La
Vérité, 27 avril, Œuvres, 3, pp.
309-310.
26
Journal d'exil, 25 mars 1935, p.74.
27
Rapport du Procureur de Melun, 15
avril 1934, Archives nationales.
29
Journal
d'exil, pp.
66-69.
30
Le Matin, 17 avril 1934.
31
Van,
op. cit., p. 101.