(1877-1954)
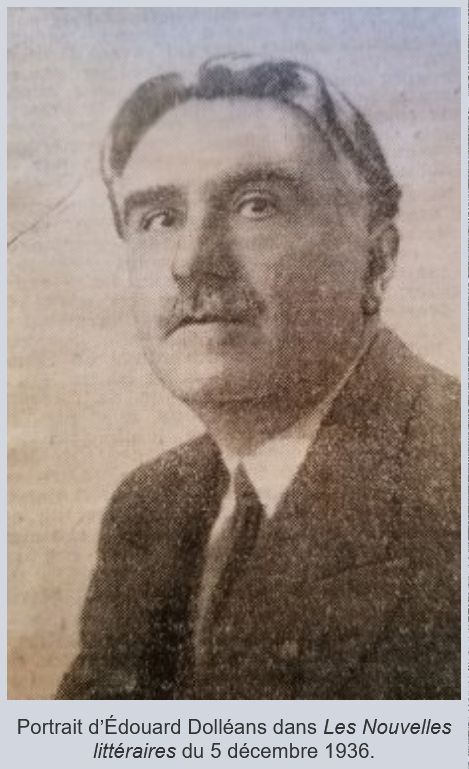
Né le 9 avril 1877 à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), mort le 2 septembre 1954 à Villeblevin (Yonne) ; professeur d’économie, fonctionnaire international, membre de cabinets ministériels, historien du mouvement ouvrier.
Édouard Dolléans était le fils de Jean-Baptiste, Aimé Pellorce, principal clerc de notaire, et de Marthe, Léonie Dolléans. Il naquit dans la « résidence secondaire » de ses parents au « chalet de Tilly » à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), leur foyer principal se trouvant au 27, boulevard Poissonnière à Paris. Le couple eut aussi une fille, Léonie, Jeanne, Marie (1891-1962), épouse d’Edgard Depitre, agrégé des facultés de droit. Suite à la condamnation de son père à quatre ans de prison ferme pour escroquerie, en 1895, Édouard Pellorce obtint, en 1902, l’autorisation de prendre le nom de sa mère et de s’appeler ainsi Édouard Dolléans. Sa sœur fit de même. Il se maria le 9 décembre 1907 à Édulphie, Adèle, Marcelle Loye (1877-1957), « sans profession » selon l’état-civil. Le couple eut une fille, Marie-Thérèse, Aimée, Augustine Dolléans (1911-1990), qui épousa en 1935 Georges Monier (1898-1956), directeur régional des Assurances Sociales à Lyon, alors chargé de mission à la Présidence du Conseil. Pierre Laval fut un des témoins de ce mariage.
Édouard Dolléans suivit des études de Droit à la faculté de Paris, fut licencié en 1899 et lauréat du « Prix Ernest Beaumont » (premier prix de Droit civil). En 1902 et 1903, il rédigea successivement deux doctorats en Droit, l’un pour la mention « Sciences juridiques » (La police des mœurs) et l’autre pour la mention « Sciences politiques et économiques » (De l’accaparement). Après un premier échec en 1903, il obtint l’agrégation de Droit, mention « économie politique », en 1906. En parallèle de ses études, de 1900 à 1902, il commença sa carrière comme « attaché au secrétariat » de la Société des Mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne (Angleur, Belgique).
L’obtention de son doctorat entraîna les débuts de sa carrière universitaire. Il devint, de 1903 à 1906, chargé de conférences à la faculté de Droit de Paris puis fut chargé du cours d’économie politique à la faculté de Droit de l’Université de Lille, de 1906 à 1908, en remplacement du député Charles Guernier. Cependant, il ne fit pratiquement pas cours, étant en congé maladie la majeure partie du temps. En 1908, il fut transféré, à sa demande, à la faculté de Droit de Dijon. Nommé « professeur-adjoint » en 1911 puis professeur en 1913, il enseigna l’économie politique et l’histoire des doctrines économiques. Il donna, en parallèle, quelques conférences au Collège libre des sciences sociales, ainsi que dans des universités populaires.
S’il commença une carrière d’économiste, en écrivant notamment sur le « comptabilisme », il se tourna rapidement vers l’histoire du mouvement ouvrier, à laquelle il consacra toute sa vie. Il aborda cette histoire par l’Angleterre, en consacrant plusieurs études à Robert Owen, dont il se fit le biographe en 1905 après un voyage en Angleterre, et au chartisme. Ces travaux novateurs lui valurent les prix « François-Joseph Audiffred » (1909) et « Halphen » (1914). En 1910, il fit un détour par la philosophie pour éditer le Code de la nature ou le véritable esprit de ses lois rédigé en 1755 par le philosophe Étienne-Gabriel Morelly, précurseur du socialisme. En parallèle de ses activités scientifiques et enseignantes, il côtoya Charles Péguy, par l’intermédiaire de Geneviève Favre, et devint très lié avec Henri Bergson. De plus, il publia plusieurs articles dans La Revue socialiste.
La Première Guerre mondiale marqua un tournant dans sa carrière. Exempté du service militaire et réformé au moment de l’incorporation, Édouard Dolléans se mit à la disposition de la Croix-rouge et devint brancardier à la gare Porte-Neuve à Dijon en 1914. En août 1915, il fut nommé interprète auprès de l’armée britannique à Rouen (Seine-Inférieure, Seine-Maritime) puis « officier interprète pour la langue anglaise à titre temporaire » en novembre 1917.
En avril 1919, il débuta une carrière de fonctionnaire international et fut mis à la disposition du Commissariat général des affaires de guerre franco-américaines. En son sein, il participa plus particulièrement à la mission économique, présidée par Eugène Schneider. Grâce à ses services rendus, il fut nommé en juin 1920, secrétaire général de la Chambre de commerce internationale, tâche à laquelle il se consacra pleinement durant dix ans, de 1923 à 1933. À son départ, cette organisation regroupait plus d’un millier de chambres syndicales, d’industriels, de chambres de commerces réparties dans 47 pays. Dans une lettre à Joseph Paul-Boncour, René-Paul Duchemin (président de la Confédération générale de la production française) précisa qu’Édouard Dolléans « a refusé toute décoration française, tout avantage personnel afin de témoigner de son désintéressement et d’assurer son indépendance » (lettre du 23 mai 1933). Il quitta l’organisation internationale à sa demande et réintégra son poste de professeur à la faculté de Dijon en novembre 1933. Durant cette période, s’il écrivit peu d’articles, il s’essaya à la littérature en publiant deux recueils de textes, Équations à six inconnues (1929), publié à seulement 120 exemplaires en collaboration avec l’artiste roumaine Irène Codréano, et Le Col d’Organdi (1931). Dans ces deux ouvrages, il proposa différents portraits de femmes décrits sous l’angle de la morale.
Dès son retour à Dijon, il chercha à en partir et à se trouver « une situation à Paris ». En janvier 1933, il se présenta à l’élection pour la chaire de Géographie et d’Économie politique du Collège de France, face à André Siegfried et Charles Brouilhet. Il arriva en seconde position. Dans une note émanant du cabinet du ministre de l’Instruction publique, outre le Collège de France, deux établissements furent évoqués : le Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) et l’École pratique des Hautes Études (EPHE). Mais ces démarches n’aboutirent pas. Son départ de la Chambre de commerce internationale marqua aussi la reprise d’une intervention militante. Il se rapprocha alors des fondateurs de la « Troisième force » (André Déléage, Georges Duveau, Louis-Émile Galey et Georges Izard) et de La Jeune République, deux partis liés au christianisme social. Il collabora régulièrement avec La Jeune République, donnant conférences et articles. Cependant, il n’y adhéra jamais.
Sur le plan syndical, il se rapprocha du courant « planiste » de la CGT et prit part aux rencontres de Pontigny présidées par Henri de Man en 1934. La même année, il participa à la création de la revue dirigée par Pierre Ganivet, L’Homme réel. Revue du syndicalisme et de l’humanisme, revue qui joua un rôle central pour les planistes français. Il développa durant ces premières années de la décennie 1930 une pensée politique originale prenant sa source chez Proudhon, dans le syndicalisme-révolutionnaire — il fut proche du noyau de La Révolution Prolétarienne — chez Henri Bergson et dans le pacifisme. Il en résulta une vision morale et individuelle, teintée de mysticisme et d’antimodernisme, dont son petit livre Victoire des obscurs, publié aux lendemains de la victoire du Front Populaire (septembre 1936), fut le témoin. Pour Édouard Dolléans, « une révolution véritable ne peut s’achever par la seule transformation des institutions et des lois, mais par une rénovation du cœur de l’homme » (Victoire des obscurs, p. 36).
En juin 1936, Léo Lagrange le nomma chef de cabinet de son sous-secrétariat d’État aux Sports et au Tourisme, après le refus de Pierre Marie. Il s’engagea alors pour développer les loisirs populaires, en particulier les musées et les bibliothèques. Membre de l’Association populaire des amis des musées, il mena surtout une importante action en faveur de la lecture publique. En décembre 1936, il devint président de l’Association pour le développement de la lecture publique (ADLP) et fit entrer dans son bureau Georges Duveau, Georges-Henri Rivière (sous-directeur du musée d’Éthnographie) et Georges Bourgin. Grâce à sa position dans le gouvernement et cette association, il obtint notamment la subvention qui permit la création du premier bibliobus français en 1937. Tout en s’opposant aux tenants de la « crise du livre », il se montra enthousiaste vis-à-vis de la TSF qui, selon lui, reliait les hommes entre eux et leur permettait de prendre conscience de leur destin commun. A contrario, il vit dans le cinéma « le danger le plus insidieux […], la manière la plus douce et la plus engourdissante de ne pas penser » (Histoire du mouvement ouvrier. Tome III, p. 255).
Ayant à cœur l’éducation ouvrière, il proposa, avec Pierre Boivin à la direction du Centre confédéral d’éducation ouvrière (CCEO) de la CGT, la création d’une « École Normale d’Éducation Ouvrière destinée à former les maîtres devant assurer l’enseignement dans les collèges du Travail de province ». Mais ce projet obtint un soutien réservé de la part de Ludovic Zoretti et fut reçut avec circonspection par le couple Lefranc (Émilie et Georges), dirigeant du CCEO. Cette école ne vit jamais le jour. En juillet 1937, il changea de ministère et pris la tête du cabinet de Philippe Serre, nouveau sous-secrétaire d’État au Travail et membre de La Jeune République. Il le suivit ensuite au sous-secrétariat d’État chargé des services de l’immigration et des étrangers (février-mars 1938) puis de nouveau au sous-secrétariat d’État au Travail (mars-avril 1938). Ce passage par les cabinets ministériel ne fut cependant qu’une parenthèse dans sa carrière universitaire. Dès novembre 1936, une note du ministère de l’Éducation nationale évoqua deux possibilités pour le « cas Dolléans » : création d’une chaire d’histoire du travail à la faculté de Droit de l’Université de Paris ou direction de la future École d’administration. Une seconde note évoqua une chaire « sur l’histoire du mouvement ouvrier » venant compléter la chaire d’histoire du travail du Collège de France, alors occupée par le médiéviste Émile Coornaert. Finalement, en 1938, Jean Zay créa une chaire d’Histoire du Travail à la faculté de Droit de l’Université de Paris et y nomma Édouard Dolléans. Cette création et cette nomination ne furent pas sans provoquer quelques remous au sein de la faculté, notamment avec Edgar Allix, doyen de celle-ci. De plus, dès 1937, il entra à l’École pratique des Hautes Études comme suppléant d’Adolphe Landry, en compagnie de Georges Bourgin et Gaétan Pirou. Il y intervint jusqu’en 1939 sur : « L’Évolution sociale en France du 2 décembre 1851 à 1871 » (1937) ; « L’Évolution du mouvement ouvrier et de la paysannerie en France de 1871 à 1902 » (1937-1938) ; « La Commune de Paris (du 4 septembre 1870 au 20 mars 1871) » (1938-1939).
Durant la seconde moitié des années 1930, Édouard Dolléans s’imposa véritablement comme historien du mouvement ouvrier avec la publication des deux premiers tomes de son Histoire du mouvement ouvrier en 1936 (tome 1 : 1830-1871) et 1939 (tome 2 : 1871-1936), son « grand œuvre » qui marqua un tournant historiographique. S’il participa à l’inauguration de la filiale française de l’Institut international d’histoire sociale en 1937 et aux travaux de la Commission internationale d’histoire des mouvements sociaux (Comité international des sciences historiques), son action se concentra essentiellement sur le plan national et fut indissociable de celle de Georges Bourgin. En 1937, ils tentèrent de créer avec Julien Cain un service d’archives au sein de la CGT, dans le cadre du CCEO, mais ce projet fut mis en échec par le second conflit mondial. L’année suivante, il créa, toujours avec Georges Bourgin, une collection d’histoire sociale chez Domat-Montchrestien, dans laquelle ils publièrent les premières thèses d’histoire des ouvriers et du mouvement ouvrier à partir de 1941. En lien avec ses activités historiques, il intervint régulièrement au sein du CCEO pour donner des conférences sur l’histoire du mouvement ouvrier et en particulier sur ses « grandes figures » : Victor Griffuelhes, Alphonse Merrheim, Fernand Pelloutier, Eugène Varlin. Plusieurs de ces conférences furent ensuite publiées sous la forme de petites brochures à destination des militants.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il poursuivit sa carrière universitaire en tant que professeur d’Histoire du Travail à l’Université de Paris. De ses cours, il tira une Histoire du travail publiée en 1943 et rééditée en 1945. Une édition augmentée d’un second volume et rédigée en collaboration avec Gérard Dehove fut publiée entre 1953 et 1955. La rédaction de ce livre lui permit « d’échapper au choc brutal de la défaite [et de maintenir] une volonté d’espoir » (Histoire du travail, 1943). Il vint compléter son Histoire du mouvement ouvrier et l’élargir tant au niveau des bornes chronologiques (XIXe-XXe siècle) que du sujet traité, en retraçant l’histoire de tous les milieux, y compris patronaux. Dans sa première édition, il consacra de nombreuses pages à l’analyse de la Charte du Travail, pages qu’il supprima dans l’édition suivante. S’il reconnut que la Charte du Travail portait atteinte aux syndicats, il la qualifia malgré tout de « victoire éphémère » (édition de 1945). De plus, il se rendit plusieurs fois au Portugal, pour donner des conférences à l’Université de Lisbonne, à l’invitation de José Caeiro da Matta, ancien ministre de Salazar et recteur de l’Académie de Lisbonne. Il en profita pour rendre visite à sa fille dont le mari y fut nommé « ministre plénipotentiaire » de Vichy après avoir été le secrétaire général du Commissariat générale aux questions juives. Enfin, il publia au printemps 1944 chez Denoël, Drames intérieurs, une tentative d’explication d’œuvres littéraires par la psychologie des auteurs. Il se concentra alors sur Mary Wollstonecraft, William Godwin, Proudhon, Charles Gide, Bernard Shaw, Charles Péguy et Mme Favre, François Mauriac, André Vigneau. Ce livre fut interdit par les autorités allemandes dès sa parution, selon Armand Hoog à cause des pages consacrées à François Mauriac. En raison de son attitude durant l’Occupation et suite à une enquête, il fut admis à la retraite le 1er octobre 1944. Cette sanction ne l’empêcha pas, cependant, d’apparaître au sein du Comité national des écrivains en 1945.
Après la guerre, Édouard Dolléans se concentra essentiellement sur ses activités scientifiques personnelles et collectives. Il relança la Revue d’histoire économique et sociale en compagnie notamment d’Ernest Labrousse et de Georges Bourgin et participa à la création de la revue Les études bergsoniennes en 1948. Membre de la Société d’histoire de la IIIe République, il en devint le vice-président ; il apparut aussi dans le comité directeur de la Société de 1848. Mais le fait le plus marquant de cette période fut certainement la création, en compagnie de Georges Bourgin et de Jean Maitron, de l’Institut français d’histoire sociale (IFHS) en 1948, dont il devint le vice-président. Il s’y consacra jusqu’à la fin de sa vie. En parallèle de ces entreprises collectives, il maintint une importante activité éditoriale en tant que directeur de collections. Il co-dirigea la « Bibliothèque d’histoire économique et sociale » aux éditions M. Rivière en compagnie de Georges Bourgin et Ernest Labrousse et créa la collection « Masses et militants » aux Éditions ouvrières. Dans cette collection, il publia plusieurs biographies de militants (dont la biographie de Paul Delesalle par Jean Maitron ou sa biographie de George Sand) ainsi que des études plus générales sur le mouvement ouvrier et les ouvriers. Enfin, il publia durant cette période ses deux derniers livres : une biographie de Proudhon rédigée entre 1941 et 1947 à la demande de son ami Jean Paulhan et publiée chez Gallimard et surtout, le troisième et dernier tome de son Histoire du mouvement ouvrier, qui mit un point final à son œuvre en 1953. Sur le plan politique et syndical, bien qu’en retrait, il s’engagea en faveur de la construction européenne et se rapprocha de la CGT-FO.
Il décéda le 2 septembre 1954 à Villeblevin (Yonne) et fut enterré au cimetière du Père Lachaise en compagnie de plusieurs membres de sa famille (16e section, chemin de Labedoyere). Sa femme puis sa fille firent don de sa bibliothèque à l’IFHS.
Édouard Dolléans laissa derrière lui une œuvre importante et marquante, tant pour les militants que les historiens s’intéressant à l’histoire des ouvriers et du mouvement ouvrier. Dès le début de sa conversion à l’histoire, il alterna études biographiques (R. Owen, V. Griffuelhes, A. Merrheim…) et études plus générales sur le mouvement ouvrier. Profondément influencé par Henri Bergson, il vit dans les militants, des « hommes exceptionnels » incarnant une morale nouvelle et capables, par leurs actions, d’entraîner les « obscurs » et la société vers plus de justice. Il en résultait une vision morale et mystique du militantisme et de la classe ouvrière. Tout au long de son œuvre, tant dans ses études historiques que dans ses écrits littéraires, il porta une attention particulière aux rôles des individus et à leur psychologie. Une question apparaît en fil rouge, lui donnant une profonde cohérence : le problème des relations entre les masses et les militants. S’il fit de cette question une collection éditoriale, il en fit aussi, au même moment, le sujet d’une enquête qu’il mena avec Georges Vidalenc et Michel Collinet, dans le cadre de la Revue d’Histoire économique et sociale. De par son œuvre et son action au sein de différentes institutions, en particulier l’IFHS, Édouard Dolléans peut être considéré comme l’un des « pères fondateurs » de l’histoire ouvrière.
Biographie du Maitron : https://maitron.fr/spip.php?article22805
Archive Édouard Dolléans :